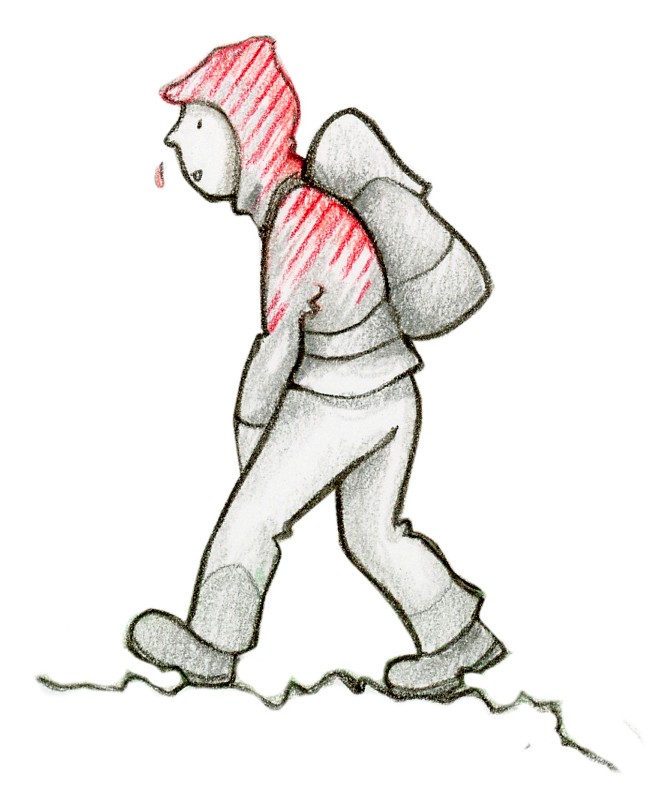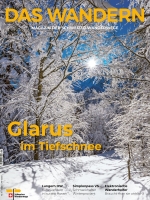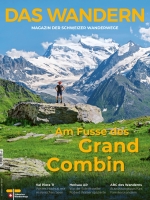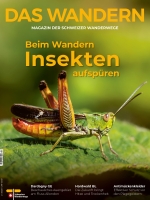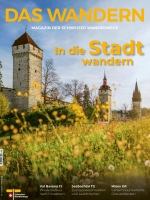Les vêtements de plein air ont pour but de maintenir le corps humain dans sa zone de confort individuelle le plus longtemps possible, lors d’activités sportives ou de conditions météorologiques changeantes. C’est-à-dire qu’il n’ait ni trop froid, ni trop chaud, et qu’il reste au sec autant que possible.
Dans la pratique, le principe de l’oignon a fait ses preuves en randonnée: plutôt qu’une couche, plusieurs couches de vêtements sont superposées et permettent de réagir avec rapidité et flexibilité aux changements de conditions extérieures.
La peau continue à transpirer durant la pause
Un bon exemple à cet égard est la pause effectuée après une ascension difficile. Le passage d’un effort intense à une phase de repos engendre différents processus physiologiques, le corps réagissant parfois de manière décalée à la nouvelle situation. Cette phase transitoire est critique pour la sensation de chaleur, la thermorégulation et le bien-être.
La température corporelle reste d’abord accrue, y compris après l’arrêt, et les glandes sudoripares continuent de travailler, bien qu’aucune chaleur ne soit alors produite par le travail des muscles. C’est pourquoi nous continuons à transpirer. Or, le corps humide refroidit rapidement s’il y a du vent ou qu’il fait froid. La surface du corps reste chaude et humide, ce qui entraîne une déperdition de chaleur excessive en cas d’inactivité soudaine. La fraîcheur auparavant bénéfique à l’évaporation devient un inconvénient et accroît le risque d’hypothermie, surtout en cas de vent, d’ombre ou de vêtements mouillés. C’est donc le moment d’enfiler quelque chose de chaud.
Le vent refroidit vite le corps
Il serait encore plus efficace de revêtir un coupe-vent par-dessus. Au sommet, le corps est à la merci du vent et de la météo. Le risque de se refroidir rapidement est grand, car les vêtements sont humides et la transpiration s’évapore plus vite qu’il ne le faudrait. A cela s’ajoute «l’effet windchill». Ce concept désigne le phénomène selon lequel un air froid semble encore plus froid qu’il ne l’est en réalité lorsque le vent souffle. La différence de température ressentie peut être énorme: une température extérieure de +5 °C avec un vent à 40 km/h devient une température ressentie de –5 °C.
Première couche: les sous-vêtements fonctionnels
Les sous-vêtements fonctionnels qui se trouvent à même la peau absorbent la transpiration et l’évacuent vers l’extérieur. Durant les pauses, ces sous-vêtements doivent sécher aussi vite que possible et éviter ainsi de trop se refroidir.
Conductivité de l’eau
La première couche textile doit absorber la transpiration, la répartir sur une grande surface et l’évacuer vers les couches de vêtements extérieures. Idéalement, elle doit le faire à une vitesse qui ne neutralise pas complètement la fonction naturelle de refroidissement de la sueur.
Temps de séchage
L’eau conduit environ 25 fois mieux que l’air. C’est pourquoi une première couche humide prive le corps de chaleur, que les vêtements soient mouillés à cause de la pluie ou de la transpiration. Le choix du matériau est donc crucial: le coton sèche très lentement, en plus de deux heures, ce qui le rend peu adapté aux activités sportives. Selon l’épaisseur de fil, la laine mérinos met elle une heure à une heure et demie à sécher, tandis que les microfibres en polyester ont besoin de seulement 15 à 30 minutes.
Deuxième couche: l’isolation
La couche d’isolation capte l’air. La chaleur corporelle ne se dissipe ainsi pas trop rapidement, tandis que le froid extérieur ne pénètre pas jusqu’au corps. En conséquence, la deuxième couche ne réchauffe pas: elle conserve la chaleur du corps et bloque la fraîcheur ambiante.
L’air conduit très mal la chaleur. Cette propriété est exploitée par les vestes isolantes, dont le rembourrage est constitué d’épais coussins d’air: le duvet capture entre 85 et 90% d’air, les fibres synthétiques entre 70 et 85% et le rembourrage en laine entre 60 et 70%.
Avantages et inconvénients des matériaux
Le duvet, les fibres synthétiques et le rembourrage en laine ont tous des avantages et des inconvénients. Le duvet fournit la meilleure isolation tant qu’il est sec. Mouillé, sa performance chute drastiquement. Les fibres synthétiques isolent bien, même mouillées, et sèchent rapidement. La laine offre elle une isolation moyenne et sèche relativement vite.
Le duvet a le meilleur rapport entre poids et performance thermique et prend le moins de place, mais il coûte cher et demande de l’entretien. Les fibres synthétiques sont faciles d’entretien et peu coûteuses, mais elles sont plus volumineuses. Le rembourrage en laine est également facile à entretenir et peu cher, mais il est plus lourd et moins compressible.
Mécanisme de la perte de chaleur
Outre l’humidité, l’isolation peut aussi être réduite pas d’autres éléments: un sac à dos reposant contre le corps écrase ainsi les coussins d’air. Si les vêtements sont trop grands ou trop petits et ne sont pas bien ajustés, cela entraîne aussi une perte de chaleur corporelle.
Enfin, le corps perd de la chaleur à cause des ponts thermiques. Ces derniers doivent être prévenus dès l’achat des vêtements, par exemple en évitant les fermetures éclair sans patte ou un trop grand nombre de coutures.
L’impasse est souvent faite sur les jambes pour la couche isolante. Cela se paie, par exemple au moment de faire la pause sur un rocher froid: ce pont thermique entraîne alors une perte rapide de chaleur.
Troisième couche: la protection contre les intempéries
La couche extérieure protège le corps du vent, de la pluie et de la neige, tout en évacuant l’humidité due à la transpiration. Les laminés ont deux ou trois couches: le textile de support et la membrane forment la base, tandis qu’une doublure ou un revêtement constituent la troisième couche.
La capacité d’un laminé à évacuer la sueur du corps vers l’extérieur est indiquée par les unités de mesure MVTR (moisture vapor transmission rate) ou RET (resistance to evaporating heat transfer). Plus la valeur MVTR est élevée, mieux c’est. Plus la valeur RET est basse, mieux c’est.
La protection contre les intempéries et la perméabilité à la transpiration de la troisième couche sont limitées par:
Limites de performance de la membrane
Toutes les membranes n’affichent pas la même performance. Et même les meilleurs produits ne peuvent évacuer qu’environ 1 litre de transpiration par heure dans les conditions idéales (qui sont rarement réunies). En cas d’activité physique intense, le corps humain peut produire entre 1 et 3 litres de sueur. Toute veste, aussi fonctionnelle soit-elle, atteindra alors ses limites de performance.
Ecarts limités de températures et d’humidité
Plus les écarts de températures sont grands, plus la protection de la veste contre les intempéries est efficace. L’idéal est d’avoir 32 degrés à l’intérieur de la veste et 15 degrés à l’extérieur.
L’humidité à l’intérieur et à l’extérieur de la veste joue également un grand rôle: plus l’écart est grand, plus la transpiration peut être évacuée efficacement dans l’air ambiant. Le mieux est d’avoir une humidité très élevée de l’air à l’intérieur de la veste et un air très sec à l’extérieur.
Dans des conditions tropicales aux températures élevées avec une humidité relative de quasi 100%, l’évacuation de la transpiration est nulle. Sous nos latitudes, il ne faudra pas non plus s’étonner si la veste atteint ses limites de performance lors d’un orage d’été accompagné de températures élevées et d’une forte humidité ambiante.
Températures basses
L’air chaud peut absorber davantage d’humidité que l’air froid. Plus l’air environnant est froid, moins le laminé peut évacuer de transpiration. Avec des températures inférieures à zéro en particulier, les vestes coupe-vent perdent fortement en respirabilité.
Mauvaise imperméabilisation
Toutes les imperméabilisations ne se valent pas. Elles perdent néanmoins toutes en efficacité avec le temps. Si le matériau extérieur se gorge d’eau en conséquence, la membrane qui se trouve en dessous ne peut évacuer que peu de transpiration. Cela s’appelle «l’effet wet out».
La chaleur (fer à repasser au niveau minimal ou sèche-linge) permet parfois de réactiver l’imperméabilisation. La veste coupe-vent peut autrement être à nouveau imperméabilisée à l’aide d’un produit spécial adapté.
L’UE a récemment interdit le traitement des textiles avec des produits chimiques per- et polyfluorés (PFC/PFAS). Ces substances ont longtemps été utilisées pour rendre des matériaux résistants à l’eau, aux salissures et aux graisses. Elles nuisent toutefois à la santé et à l’environnement et ne se dégradent pas dans la nature. Le revers de la médaille, c’est que les imperméabilisations alternatives sont nettement moins performantes.